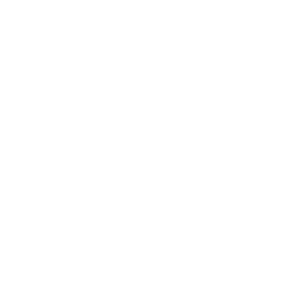Depuis 2018, toute entreprise de plus de 250 salariés doit désigner un référent handicap.
Mais sur le terrain, cette fonction clé reste souvent floue, mal outillée ou invisible.
Entre obligation légale et enjeu humain, voici pourquoi il est temps de lui redonner toute sa place.
Quand un simple aménagement devient un casse-tête
Demander un aménagement de poste ne devrait pas relever du parcours du combattant.
Cependant, dans nombre d’entreprises, la chaîne de décision se fragmente entre RH, managers et médecine du travail.
Chacun agit dans son périmètre, sans coordination réelle ni vision globale.
Le médecin du travail formule des préconisations, mais leur mise en œuvre se perd dans les circuits internes. Les RH cherchent des dispositifs, les managers s’interrogent sur la faisabilité, la direction arbitrera plus tard.
Résultat : les délais s’allongent, les tensions montent, la confiance s’érode.
Pourtant, depuis 2018, la loi impose un référent handicap chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés concernés dans les entreprises de plus de 250 salariés.
Ce rôle devait fluidifier les échanges, créer un point d’appui unique entre les acteurs, et donner un visage concret à la politique handicap.
Mais dans de nombreuses structures, la fonction reste théorique et le référent handicap encore peu identifié..
Selon une étude Agefiph–IFOP publiée en novembre 2024, moins d’une entreprise sur deux respecte cette obligation. Et parmi celles qui ont désigné un référent handicap, beaucoup n’ont pas encore défini de périmètre d’action précis.
Derrière cette statistique se cachent un manque de pilotage, des incompréhensions, et parfois une perte de sens au travail.
Au-delà de la conformité légale, le référent handicap peut pourtant devenir un véritable point d’ancrage entre santé, management et cohésion sociale.

1. Référent handicap : un rôle obligatoire, mais encore flou dans les entreprises
1. Une obligation légale claire… sur le papier
L’article L. 5213‑6‑1 du Code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018, impose à chaque entreprise de désigner un référent handicap. Sa mission : orienter, informer et accompagner les salariés concernés.
Ce rôle devait instaurer une interface entre RH, médecine du travail, managers et partenaires externes (Agefiph, Cap Emploi).
Toutefois, le dispositif a souvent été appliqué sans cadre opérationnel précis.
Dans certaines organisations, un nom a été communiqué pour se conformer à la loi, sans que la mission, le temps ou les moyens soient clairement définis. Sans pilotage réel, le référent handicap ne peut donc jouer pleinement son rôle.
2. Une application en demi-teinte
D’après l’Agefiph, la France compte environ 674 000 salariés handicapés, pour un taux d’emploi direct de 3,6 % dans les entreprises soumises à l’obligation de 6 %.
Ce décalage ne s’explique pas seulement par les chiffres : il révèle aussi un déficit d’accompagnement interne et d’identification claire du rôle du référent handicap.
La loi est connue, mais son application reste lacunaire. Sans pilotage concret, la fonction peine à incarner le levier d’inclusion et de performance qu’elle devait être.
2. Un rôle pivot au cœur de la performance sociale
1. Le référent handicap, médiateur et facilitateur
Lorsque la fonction est reconnue, ses effets sont immédiats.
Une étude de l’OCIRP (2023) indique que la présence d’un référent handicap identifié améliore le maintien dans l’emploi de 18 % et réduit de 20 % les arrêts de longue durée liés au handicap.
Le référent handicap traduit les préconisations médicales en mesures concrètes, guide les managers parmi les dispositifs disponibles et prévient les situations de rupture professionnelle.
Il n’est ni expert médical, ni juriste, mais un médiateur capable d’articuler les contraintes humaines, organisationnelles et légales.
2. Un indicateur de maturité sociale
La présence active d’un référent handicap reflète la qualité du dialogue interne.
Selon la Dares (2024), 82 % des entreprises ayant formé leur référent estiment avoir renforcé la communication entre managers et salariés.
Et selon l’étude IFOP–Agefiph (2024), les salariés s’y déclarent deux fois mieux informés sur leurs droits et les dispositifs d’aménagement.
À l’heure où la performance extra‑financière devient un enjeu central, la fonction de référent handicap prend aussi une place visible dans les politiques RSE et les rapports sociaux.
3. Pourquoi la fonction peine encore à s’imposer
1. Un rôle sans périmètre défini
Dans la majorité des entreprises, le référent handicap cumule plusieurs casquettes (RH, QVT, prévention, égalité).
Faute de temps dédié ou de rattachement clair, la fonction reste marginale et difficile à identifier.
Selon l’Agefiph, 7 référents sur 10 ne disposent pas d’une demi‑journée hebdomadaire pour exercer leur mission.
2. Un besoin de formation reconnu
Les enjeux du handicap mobilisent à la fois le droit, la santé au travail, la psychologie et le management.
Pourtant, aucune formation spécifique n’est imposée par la loi.
L’étude IFOP–Agefiph (2024) montre que 53 % des référents n’ont reçu aucune formation dédiée, limitant leur capacité à accompagner efficacement salariés et encadrants.
3. Une faible visibilité interne
Dans de nombreuses structures, peu de collaborateurs connaissent l’existence du référent handicap.
L’absence de communication entretient l’isolement. De fait, un rôle méconnu devient rapidement un rôle inactif.
4. SEEPH 2025 : une occasion d’agir
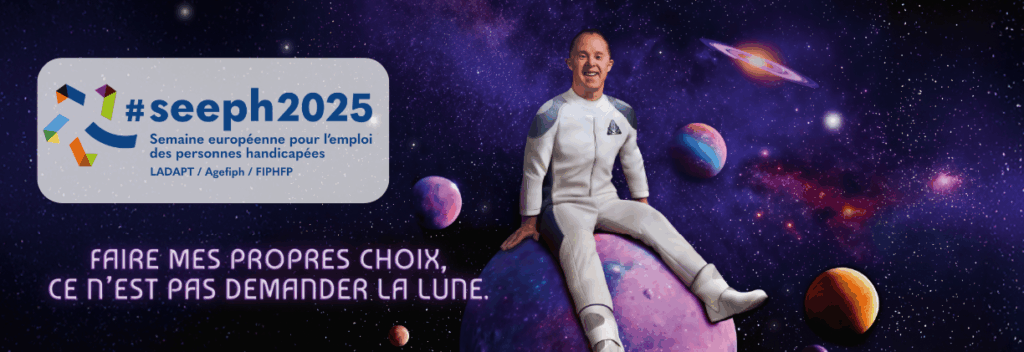
1. Faire un état des lieux interne
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, du 17 au 23 novembre 2025, offre un cadre privilégié pour questionner la place du référent handicap dans l’organisation.
Qui occupe cette fonction ? Quelle est sa formation ? Dispose‑t‑il d’un plan d’action et d’indicateurs ?
2. Trois leviers immédiats
- Clarifier la mission : formaliser la fiche de poste et fixer un temps de mission reconnu.
- Outiller le référent handicap : mettre à disposition guides, fiches réflexes et supports d’entretien.
- Le rendre visible auprès des équipes : communiquer en interne sur son nom, son rôle et ses coordonnées.
3. Des effets mesurables à court terme
Les entreprises qui ont clarifié le rôle du référent handicap constatent une diminution de 40 % des délais d’aménagement, une hausse de 25 % des déclarations RQTH et un gain de 30 % sur la satisfaction des salariés accompagnés (panel Agefiph 2024).
5. Professionnaliser le rôle : un investissement stratégique
1. Des parcours de formation dédiés
De plus en plus d’organismes, dont Doxa Formation, proposent des formations ciblées sur la posture et les pratiques du référent handicap :
- comprendre le cadre légal,
- adopter la bonne posture d’écoute,
- dialoguer avec les acteurs internes et mesurer les actions.
Ces formations permettent de transformer un rôle souvent administratif en poste‑pivot opérationnel.
→ Découvrir la formation « Référent handicap » de DOXA Formation
2. Des résultats concrets
Les entreprises formées constatent en moyenne :
- +32 % de situations traitées efficacement,
- +21 % de satisfaction RH, et,
- -18 % de tensions liées aux aménagements.
La clarification du rôle du référent favorise une culture managériale plus inclusive et réactive.
6. Et après ? Faire évoluer le rôle de référent handicap vers un changement durable
1. Un miroir de la culture d’entreprise
Le référent handicap incarne la capacité d’une organisation à écouter, ajuster et prévenir.
Il dépasse la seule question du handicap pour devenir un repère de cohérence sociale.
Dans un contexte marqué par l’allongement des carrières et les pathologies chroniques, sa fonction devient stratégique.
2. Anticiper plutôt que subir
Selon la Dares, un salarié sur cinq sera concerné d’ici 2030 par une limitation fonctionnelle durable.
Structurer la fonction aujourd’hui, c’est prévenir les ruptures professionnelles de demain et préserver les compétences collectives.
En résumé
| Constats | Risques | Solutions |
| Fonction obligatoire mais floue | Non‑conformité, tensions RH | Clarifier missions et temps dédié |
| Référent peu visible | Salariés désorientés | Communication interne claire |
| Absence de formation | Risque d’erreurs ou d’inaction | Formation ciblée du référent |
| Suivi inexistant | Absence d’indicateurs | Mise en place de tableaux de bord |
Conclusion : Redonner sens à la fonction oubliée
Le référent handicap n’est pas une case administrative : c’est un repère humain.
Lorsqu’il est formé, identifié et soutenu, il crée un lien tangible entre droit, santé et performance.
L’enjeu n’est plus la conformité, mais la maturité.
Et si la SEEPH 2025 devenait l’occasion, pour votre entreprise, de redonner vie à cette fonction essentielle ?
Pour aller plus loin, DOXA vous conseille :

Devenir référent handicap